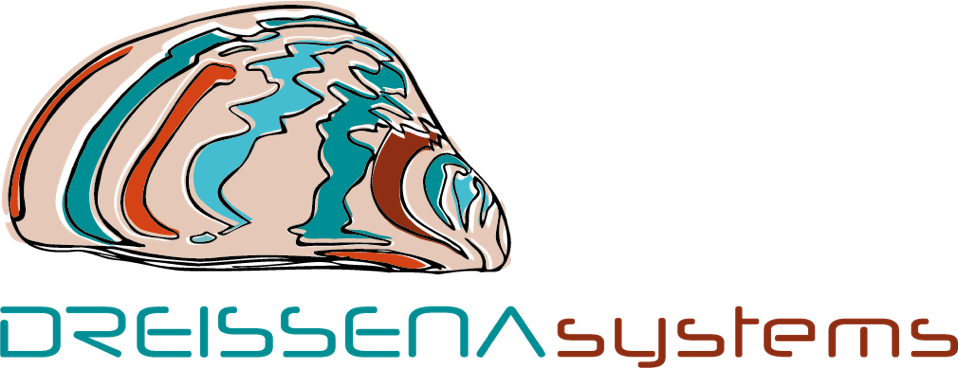

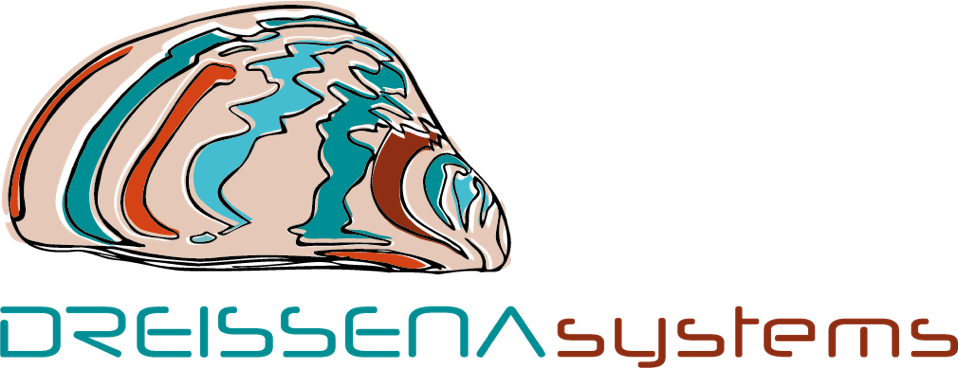

Dreissena systems
Amérique du Nord
1980
Originaire de la région du Danube, la moule quagga a été introduite dans les Grands Lacs dans les années 1980 par les eaux de ballast des navires.
Depuis, elle a colonisé de vastes portions du réseau hydrique nord-américain, provoquant des millions de dollars de dégâts annuels:
> Obstruction des conduites de refroidissement dans les centrales hydroélectriques.
> Encrassement massif des stations de pompage et des prises d’eau industrielles.
> Perturbation des écosystèmes aquatiques locaux.
Des États comme la Californie, le Nevada ou l’Arizona déploient encore aujourd’hui des programmes coûteux de contrôle et de nettoyage.
Europe
2000
Introduite par voies fluviales depuis l’Est, la moule quagga a envahi de nombreux bassins européens depuis les années 2000:
> Elle est aujourd’hui présente dans la majorité des pays d’Europe centrale.
> Elle affecte notamment le lac de Constance, le lac Léman, et plusieurs réseaux d’eau en Autriche, Allemagne et Italie.
Les infrastructures les plus touchées sont celles de captage d’eau potable, d’irrigation agricole et d’énergie hydraulique.
Suisse
2014
La Suisse n’a pas été épargnée : en 2014, la moule quagga a été découverte pour la première fois dans le lac de Constance, puis elle s’est propagée rapidement à plusieurs autres lacs et cours d’eau du pays. La prolifération dans les grands lacs romands, et particulièrement dans le Léman, représente un enjeu technique et financier majeur pour les services d’eau.
> Prolifération rapide de la moule quagga
> Obstruction des conduites
et perturbation des écosystèmes
Favorisée par :
> réchauffement climatique
> absence de prédateurs
> eaux riches en nutriments
> Coûts de maintenance très élevés
> Plusieurs millions de CHF par an
selon l’OFEV
> Coûts en hausse constante
> Méthodes actuelles coûteuses et contraignantes
> Chloration, traitement
thermique ou mécanique
Besoin de solutions :
> innovantes
> sur mesure
> écologiques
Colonisation des installations
> Les moules quagga se fixent sur toutes les surfaces immergées.
> Réduction des débits d’eau
> Pannes à répétition
> Usure accélérée des équipements
> Surconsommation d’énergie
Entretien intensif
> Nettoyage, remplacement et maintenance réguliers deviennent inévitables.
> Coûts d’exploitation en forte hausse
> Arrêts de production fréquents
> Pression sur les services publics et les industriels
Propagation rapide
> En 10 ans, l’espèce a colonisé les principaux lacs suisses.
> Présente dans les lacs et bassins (Suisse, Europe et Amérique du Nord)
> Colonisation possible de tous les grands lacs d’ici 2030
Effets environnementaux
> Un déséquilibre écologique en cascade
dans les lacs et bassins.
> Filtration excessive des particules
> Perturbation de la chaîne alimentaire
> Eutrophisation de certaines zones
> Menaces sur la biodiversité locale
Impact sanitaire
> Les infrastructures d’eau potable sont
directement concernées.
> Dégradation de la qualité de l’eau
> Risques à moyen terme pour les installations de traitement
> Nouvelles dépenses pour la sécurité sanitaire
Traitements chimiques
(chlore, peroxyde d’hydrogène)
Injection de biocides pour tuer les moules et leurs
larves.
> Risques pour la faune aquatique
> Effets néfastes sur l’environnement
> Coûts élevés d’installation et d’exploitation
> Peu compatibles avec les captages d’eau potable
Traitements thermiques
Injection d’eau chaude (40–60°C) dans les conduites.
> Efficacité localisée uniquement
> Très énergivore
> Peu réaliste à grande échelle
Filtration physique (filtres mécaniques, à sable)
Empêche les larves d’entrer dans les systèmes.
> Investissement coûteux pour gros débits
> Risque d’obstruction
> Inefficace contre les larves microscopiques
Assèchement périodique
Mise hors service temporaire des conduites.
> Inapplicable pour les systèmes en continu
> Usage très limité
Méthodes biologiques (bactéries, enzymes, prédateurs)
Techniques naturelles à l’étude pour cibler la moule.
> Interdites en milieu ouvert en Suisse
> Pas encore prouvées scientifiquement
Nettoyage mécanique (grattage, brossage interne)
Élimine manuellement les colonies installées
> Ne prévient pas les recolonisations
> Pas de protection à l’entrée (crépines)
> Rejets organiques polluants dans les lacs
utilisation de matériaux biocide
Fabrication d'éléments de crépine en alliage biocide
> Coûts très élevés à la fabrication
> Émission de ions cuivre et nickel nocifs pour l’environnement
> Effet de protection limité dans le temps
Ce site web utilise les cookies. Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus de détails.